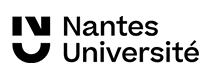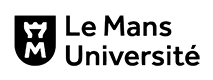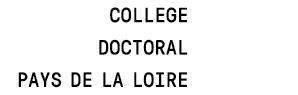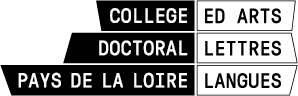AàC JSI 2026 La mémoire et l'oubli
-
Du 18 juillet 2025 au 28 novembre 2025false false
Journée scientifique interdisciplinaire de l’Ecole doctorale ALL-Pays de la Loire
Appel à communications
La mémoire et l’oubli
Vendredi 6 février 2026
9h30-17h30
Nantes Université (lieu à préciser)
Lieu : en présentiel pour les participants de Nantes et d’Angers ; en distanciel sur les sites du Mans et de l’ED ALL-Bretagne
Organisation : LAMO, Nantes Université
Conférence plénière : à préciser
Devoir de mémoire, lieux de mémoire, arts de mémoire, travail de mémoire, exercices de mémoire : cette liste normative ne trahit-elle pas la hantise des trous de mémoire ? L’articulation de la mémoire et de l’oubli permet de rendre compte à la fois de l’opposition et de la complémentarité de deux opérations qui participent du lien social et culturel. Si le souvenir des temps oubliés, des êtres humains ou des choses inertes ne peut être assuré par la seule mémoire naturelle, s’il a bénéficié de l’invention de l’écriture, verbale ou iconique, il est aujourd’hui amplifié par un encodage informatique massif qui donne l’illusion d’embrasser la totalité du passé. Pourtant, toutes ces données sont fragiles et la lutte contre leur destruction, sinon leur falsification, souligne la menace permanente de l’oubli. En outre, cette mémoire « déclarative », fondée sur des dispositifs de stockage rédactionnels conçus comme autant de protections contre l’oubli, n’affaiblit-elle pas notre capacité cérébrale à mémoriser ? La mémoire artificielle conduit-elle à une mémoire oublieuse ?
Moins consciente, parfois plus efficace, la mémoire « procédurale », repose, quant à elle, sur l’automatisation de comportements gestuels, l’habituation à certains stimulus (visuels, auditifs) qui tendent à devenir une seconde nature. Cette mémoire involontaire revêt parfois des aspects pathologiques. Depuis Freud, on sait que la compulsion de répétition peut exprimer un traumatisme inavoué, qui se donne à lire à travers des signaux de substitution, offerts au déchiffrement de l’analyste. De la mémoire refoulée à la mémoire apaisée, se dessine alors le travail du deuil, dont le pouvoir libérateur passe par les mots.
L’oubli apparaît donc comme l’un des corollaires inévitables de la mémoire, qu’elle soit individuelle ou collective, obligée, empêchée ou manipulée. Il participe d’une hiérarchisation du mémorable, sans cesse renouvelée : la réception des périodes les plus tragiques de l’humanité témoigne du caractère instable et sélectif du processus de mémorisation et des conflits d’interprétations historiques. Car l’oubli n’est pas toujours une faille épistémologique : instrumentalisé, il procède parfois d’une stratégie véridictionnelle qui vise à forcer l’adhésion. Toute entreprise mémorielle suppose un travail critique sur l’oubli.
La mémoire sert à construire l’identité personnelle à partir des événements qui forment la trame de la vie et qui n’ont parfois de consistance que pour la personne qui se les remémore. Que devient le sujet quand il a perdu le souvenir de son histoire ? L'écriture autobiographique, les journaux d'écrivains, les écrits des mémorialistes et, plus généralement, toutes les formes d’égo-documents illustrent cet effort pour donner forme et sens au moi, tout en luttant contre la peur que la maladie ou les générations à venir n’en effacent la trace. Elle résulte d’une pratique intentionnelle de la mémoire que peut déclencher, comme chez Proust, l’expérience d’une rencontre fortuite.
Mais cette dimension individuelle, liée au vécu, ne peut pleinement s’affranchir de la mémoire collective, sociale, civique, historienne. Celle-ci, parfois institutionnalisée, a partie liée avec les rapports de force, par exemple entre minorités ethniques et autorités politiques. Sous forme de récits fondateurs, elle peut servir à sortir de l’oubli des communautés considérées comme inférieures. Mettant fin au non-dit, elle donne la parole à l’horreur indicible, comme dans les récits sur l’esclavage et la littérature de la Shoah. La mémoire va de pair avec la résilience.La mémoire collective interfère aussi dans la transmission orale des formes littéraires, dans le poids des normes et des traditions qui conditionnent la production et la réception des œuvres, dans l’évolution et la compréhension des langues (la signification de certains mots, sortis d’usage, peut se perdre). L’histoire des langues et des littératures se construit au fil des modes, des censures, qui imposent leurs choix.
Enfin, on distingue la mémoire immatérielle, transmise par les images mentales, héritages linguistiques et culturels, et la mémoire matérielle, que véhiculent objets, monuments, traces physiques... L’essor des politiques patrimoniales, l’histoire locale, témoignent de l’attention accordée à la marque du temps sur ces vestiges, qui, à leur manière, font de la résistance contre l’oubli. S’y ajoute, plus récemment, la reconstitution, grâce aux technologies numériques, des patrimoines sonores disparus (https://archeoson.hypotheses.org/)
La journée d’étude, centrée sur la représentation de la mémoire et de l’oubli, propose de cerner la diversité des supports et des enjeux où s’observe leur interaction : littératures, langues, civilisations et pratiques artistiques, toutes époques confondues, constitueront le terrain d’observation pour interroger leur corrélation, voire leur déséquilibre lorsqu’un trop-plein de mémoire ou un trop plein d’oubli vient perturber notre rapport au temps.
Les communications pourront aborder les questions suivantes (liste non exhaustive) :
- L’écriture commémorative, individuelle ou communautaire, et ses silences, volontaires ou non
- Mélancolie et travail du deuil
- Le respect et l’abandon des normes littéraires et culturelles
- La construction du patrimoine et les failles de sa transmission
- La récupération des traditions orales
- Les transferts linguistiques, l’intermédialité, et leurs conséquences dans le traitement des sources
Les propositions de communications (20 min.) sont à adresser à Élisabeth Gaucher-Rémond au plus tard pour le 28 novembre 2025 :
elisabeth.gaucher@univ-nantes.fr
Les propositions comprendront :
- Nom, prénom, année d’inscription en thèse, spécialité disciplinaire, nom de l’encadrant et du laboratoire ;
- un titre et deux paragraphes rédigés, assortis d’une bibliographie succincte.
Les avis du comité scientifique seront communiqués à la mi-décembre 2025.
***
Éléments de bibliographie
Artifices de mémoire, Littérature, 175, 2014/3
Mary Carruthers, Le Livre de la mémoire. Une étude de la mémoire dans la culture médiévale, trad. de l’anglais par Diane Meur, Paris, Macula, 2002
Mary Carruthers, Machina memorialis. Méditation, rhétorique et fabrication des images au Moyen Âge, trad. de l’anglais par Fabienne Durand-Bogaert, Paris, Macula, 2002
Maurice Halbwachs, Les Cadres sociaux de la mémoire, Paris, Albin Michel, 1994 (1925)
Maurice Halbwachs, La Mémoire collective, Paris, Albin Michel, 1997 (1950)
Jacques Le Goff, Histoire et mémoire, Paris, Gallimard, 1988
La mémoire. Léon Brunschwicg, L’Archicube, 16, 2014 : https://www.archicubes.ens.fr/la-revue/anciens-num%C3%A9ros/la-m%C3%A9moire-l%C3%A9on-brunschwicg
Pierre Nora dir., Les Lieux de mémoire, 3 vol., Paris, Gallimard, 1997
Paul Ricoeur, La Mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Éditions du Seuil, 2000
Frances A. Yates, L’Art de la mémoire, traduit de l’anglais par Daniel Arasse, Paris, Gallimard (coll. « Folio histoire »), 2022 (éd. orig. 1975).
Projets de recherche et carnets Hypothèses
- La mémoire à l’épreuve de l’interdisciplinarité (Carnet des équipes Lettres, Langues et SHS d'Aix-Marseille Université affiliées au GDR interdisciplinaire 2013 « Mémoire ») : https://memoire.hypotheses.org/notre-manifestation/une-communaute-des-sciences-humaines-et-sociales-de-la-memoire-2
***
Comité scientifique
Enseignants chercheurs : à préciser
Doctorants : à préciser
Comite d’organisation
à préciser